Les Puits de Djerba : Entre Tradition et Modernité
Le1. Contexte Géographique et Hydrologique
Djerba, île aride située dans le golfe de Gabès, dispose d’une nappe phréatique peu profonde mais souvent salée. Les précipitations étant rares, les Djerbiens ont dû, depuis des siècles, creuser profondément (parfois jusqu’à 20 mètres) pour accéder à l’eau.
Problématiques Majeures
Salinité élevée → Eau non potable, réservée à l’irrigation et au nettoyage.
Pénurie en périodes sèches → Nécessité de techniques d’extraction efficaces.
2. Les Puits Traditionnels : Méthodes Ancestrales
A. Le Puits Manuel à "Soue" (Usage Familial)
Fonctionnement :
Une corde, une soue (seau) et une poulie permettent de remonter l’eau.
Méthode physiquement exigeante, limitée aux petits besoins domestiques.
Utilisation :
Approvisionnement des ménages en eau pour le nettoyage et les tâches quotidiennes.
Inadapté à l’agriculture en raison du faible débit.
B. Le Puits à Dromadaire (Pour l’Irrigation)
Fonctionnement :
Un "delou" (grand récipient en cuir) remplace la soue.
Le dromadaire, en avançant et reculant, actionne un mécanisme de levage.
Avantages :
Débit bien supérieur au puits manuel.
Permet d’alimenter une "jebia" (réservoir) pour irriguer les "jdawel" (parcelles carrées).
Symbolique :
Le dromadaire, animal robuste, incarne l’adaptation de Djerba à son environnement.
3. La Modernisation des Puits
Avec l’épuisement des nappes et la nécessité d’un débit constant, les Djerbiens ont progressivement adopté des moteurs électriques ou à diesel.
Avantages des Moteurs
✔ Gain de temps (plus besoin de traction animale).
✔ Débit régulier pour une irrigation optimale.
✔ Réduction de la pénibilité du travail.
Inconvénients
✖ Coût énergétique (carburant, électricité).
✖ Perte d’un savoir-faire traditionnel.
4. L’Eau à Djerba Aujourd’hui : Défis et Solutions
Qualité de l’Eau : Un Problème Persistant
Salinité élevée → Impossible à boire sans dessalement.
Utilisations actuelles :
Agriculture (oliviers, palmiers-dattiers).
Nettoyage et bâtiment.
Solutions Modernes
Dessalinisation (coûteuse mais de plus en plus utilisée).
Récupération des eaux de pluie (systèmes en développement).
Sensibilisation à l’économie d’eau.
5. Le Patrimoine Hydraulique de Djerba : Un Héritage à Préserver
Malgré la modernisation, certains agriculteurs maintiennent l’usage des puits à dromadaire, notamment pour :
Préserver les techniques ancestrales.
Réduire les coûts dans les zones peu électrifiées.
Tourisme culturel (démonstrations pour les visiteurs).
Conclusion : Entre Innovation et Tradition
Les puits de Djerba racontent une histoire de résilience et d’adaptation. Si les moteurs ont supplanté les dromadaires dans bien des cas, les méthodes traditionnelles restent un patrimoine vivant, témoin de l’ingéniosité djerbienne. Aujourd’hui, le défi est de concilier modernité et gestion durable d’une ressource toujours plus précieuse.

Articles similaires

Atelier de tissage à Djerba
Plongez dans l’univers fascinant du tissage traditionnel à Djerba, île emblématique de Tunisie. Découvrez les ateliers artisanaux où les mains expertes des tisserands transforment la laine et le coton en pièces uniques, témoins d’un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Entre motifs berbères, couleurs naturelles et techniques millénaires, explorez une tradition vivante qui incarne l’âme culturelle de Djerba.

Immeuble Disegni
Situé au 114 et 116 de la rue de Yougoslavie, à Tunis la capitale de la république tunisienne, l’immeuble Desegni réalisé en 1908 est l’œuvre de l’architecte Auguste Peters pour le compte d’Adolphe Disegni.
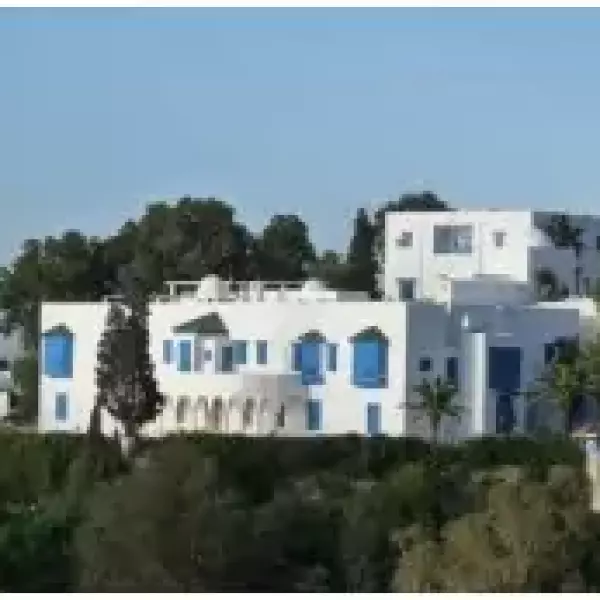
Palais du Baron d’Erlanger
Palais du Baron d’Erlanger en sidi bousaid Tunis

L’Extraction de l’Argile à Djerba : Un Métier de Passion et de Danger
À Djerba, l’extraction de l’argile est bien plus qu’un métier – c’est un héritage périlleux transmis de génération en génération. Les artisans de Guellala descendent chaque jour dans des tunnels étroits, creusés à 5 mètres sous terre, pour y extraire une argile exceptionnelle, destinée à la poterie locale. Une plongée dans l’obscurité, entre chaleur étouffante et risques d’effondrement, pour un matériau aux propriétés uniques.



